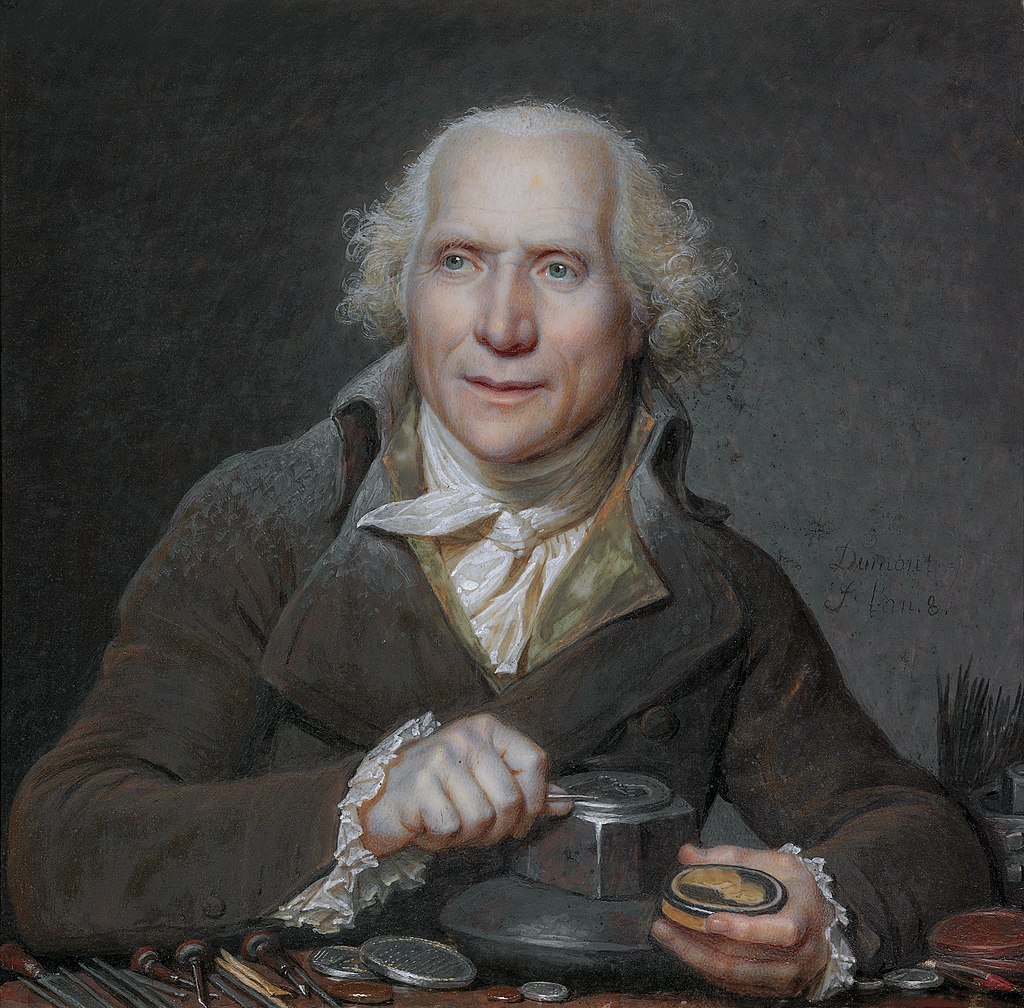Avant la frappe des pièces de monnaie, la toute première étape était celle de la gravure des matrices, appelées coins. Il s’agissait d’une étape cruciale qui prenait du temps, et qui nécessitait un savoir-faire précis et rare, car il fallait à la fois des qualités artistiques, mais plus encore techniques, et une parfaite maitrise de la métallurgie. Si les orfèvres étaient experts dans le modelage de l’argent et de l’or, peu d’entre eux savaient aussi travailler le fer et l’acier avec la précision et l’habileté requises par l’art monétaire. Aussi, s’est-il trouvé que, faute de savoir-faire locaux, des graveurs aient à fournir des matrices à plusieurs ateliers monétaires à la fois. Ce fut par exemple le cas du graveur d’Angers qui fournit les coins nécessaires à la Monnaie de Nantes de 1564 à 1570 car la cité des ducs de Bretagne ne comptait personne de « suffisamment expert au dit art » pour les réaliser localement.
©Gildas Salaün pour Monnaie Magazine 2022
Les poinçons
Préalablement à la préparation des coins, le graveur en monnaies devait tailler (d’où le nom de tailleur également employé pour désigner le graveur en monnaies) une série de poinçons. Pour ce faire, il sculptait l’extrémité de tiges de fer pour leur donner la forme d’une lettre, d’un chiffre ou d’un décor. Ces motifs, taillés en relief, étaient ensuite insculpés, c’est-à-dire emboutis, enfoncés, dans le coin. Les poinçons servaient donc à marquer chaque motif en creux dans le coin, lequel servait ensuite à imprimer l’or ou l’argent en relief.

Du Moyen-Âge à aujourd’hui…
Au Haut Moyen Âge, les coins étaient souvent gravés en taille directe. L’usage des poinçons n’était pas inconnu, mais il était encore loin d’être généralisé. C’est vers la fin du Moyen Âge, dans le courant du XIVe siècle, que cette technique s’est largement répandue. Celle-ci présentait l’énorme avantage de pouvoir gagner du temps dans la réalisation de multiples coins, mais aussi d’assurer une certaine uniformisation des matrices monétaires. Mais surtout, comme le coin finissait par s’user, se casser, il fallait le remplacer par un autre. Les poinçons permettaient alors de reproduire exactement le même dessin, car, une fois les poinçons taillés, ceux-ci étaient gardés et réemployés de coin en coin durant des années. C’est pour cela que les graveurs conservaient jalousement leurs poinçons, qu’ils les thésaurisaient comme un véritable patrimoine personnel, un authentique capital technique. Au XVIe siècle, alors que la charge de graveur particulier (graveur affecté à un atelier monétaire) devint héréditaire, on constate que les poinçons se transmettent de génération en génération par héritage. Les poinçons étaient utilisés jusqu’à ce qu’ils s’usent totalement, voire qu’ils éclatent sous les coups de marteau du graveur, car tant va le poinçon au coin qu’à la fin il se brise…

Les nouveaux moyens d’étude, grâce notamment aux grossissements photographiques, autorisent des comparaisons minutieuses entre les poinçons. Celles-ci révèlent la « vie » des outillages et des ateliers de gravure, montrent des relations entre les coins et permettent même d’établir des chronologies relatives basées sur l’usure différentielle des poinçons.

Les coins
Le coin, c’est un peu l’original d’une monnaie, ou plutôt son moule : il s’agit d’un cylindre en alliage ferreux, choisi pour sa dureté, qui porte en creux les textes et les dessins à reporter sur chaque pièce de monnaie, un peu comme une empreinte. Quand la pièce était frappée avec le coin, elle en prenait la forme, et le dessin apparaissait en relief.

Avant de se lancer dans l’insculpation de ses poinçons, le graveur, prudent, traçait au compas et à la règle des repères sur l’extrémité lisse du futur coin . Cercles et droites, appelées lignes guides, permettaient ainsi au graveur de déterminer à l’avance la position exacte de chaque élément placé selon une composition bien équilibrée. La gravure de ces repères était peu profonde, afin qu’ils disparaissent rapidement avec l’usure programmée du coin. Cependant, il peut arriver que les marques de ces tracés préparatoires soient encore observables sur les pièces (figure 6). Deux conditions pour cela : la pièce doit être frappée parmi les premières et être dans un état de conservation de qualité supérieure. Les tracés le plus souvent encore visibles sont le point de centrage et les lignes qui délimitent la légende.

Ce n’est qu’après avoir tracé « le plan » de la pièce que le graveur pouvait enfin insculper les poinçons dans le coin. Le cylindre de fer était alors chauffé, pour être « ramolli », et c’est à chaud que le graveur imprimait un par un les motifs des différents poinçons sur le coin aux emplacements déterminés par les croisements des repères.
L’autre extrémité du coin pouvait adopter deux formes différentes selon sa destination :
- Soit il s’agissait du trousseau, coin mobile destiné à être tenu en main par l’ouvrier chargé de la frappe (le monnayeur) : l’extrémité supérieure était alors tout simplement cylindrique. Le trousseau servait à marquer le revers.
- Soit il s’agissait de la pile, coin fixe destiné à être enchâssé dans une enclume ou un billot : l’extrémité inférieure était alors pointue. La pile servait à marquer l’avers.
Le trousseau, recevant les coups de marteau, s’abîmait plus vite. C’est pourquoi, les graveurs devaient souvent réaliser quatre ou cinq, voire six trousseaux pour une pile.
Les erreurs de gravures
Pour ajouter à la difficulté du travail des graveurs, rappelons que l’insculpation des poinçons devait nécessairement se faire à l’envers ! Eh oui, le coin devait être gravé en creux et à l’envers, comme une sorte de négatif, afin d’imprimer le métal en relief et à l’endroit : la pièce de monnaie était pour ainsi dire le tirage positif du coin. L’attention du graveur devait être constante, tout relâchement était immanquablement sanctionné par une erreur…
Pourtant, il est assez rare de relever les traces de ces fautes de gravure. Tout d’abord, parce les gardes (officiers chargés du « contrôle qualité ») veillaient à la conformité des pièces, autant sur le plan de leur poids et de leur titre que de leur précision graphique et esthétique. Tout comme une pièce, ou une série de pièces, jugée non conforme était immédiatement mise au rebus et refondue, un coin fauté était rejeté et devait être refait par le graveur (à ses frais !). Ensuite, l’attention des gardes n’est pas la seule raison de la rareté des fautes de gravure observables aujourd’hui. En effet, dans certains cas, les graveurs pouvaient corriger leur erreur sans avoir à refondre le coin et tout recommencer. Pour cela, ils réchauffaient les coins et insculpaient le bon poinçon sur le mauvais (figure 7). C’était la même technique employée pour la mise à jour des millésimes sur les coins encore utilisables en fin d’année (figure 8). Sur les coins ainsi corrigés on peut voir le mauvais poinçon en-dessous du bon.


Malgré ces précautions quelques exemples ont, par chance pour les collectionneurs et les chercheurs, échappé à la vigilance des gardes et des graveurs. Ces quelques cas sont généralement contemporains des périodes de forte production due à l’inflation et / ou à la guerre, deux désordres qui engendraient des cadences de production monétaire plus soutenues entrainant, sinon un relâchement, du moins une capacité de contrôle proportionnellement réduite, car les vérifications se faisant par échantillonnages.
En quoi consistent les erreurs généralement rencontrées aujourd’hui ?
Le cas le plus courant est celui de la légende fautée avec, le plus souvent, une lettre en moins.

On peut aussi régulièrement voir des points secrets mal positionnés, placés par exemple à la position inverse à celle prévue.

Enfin, on rencontre plus rarement, un motif posé au mauvais endroit.

Les rares défauts de gravure présentés ci-devant sont encore trop souvent négligés. Pourtant, ils peuvent offrir aux collectionneurs les plus observateurs une gamme de bizarreries parfois truculentes. Surtout, ils constituent des indices révélateurs des gestes et des savoir-faire d’autrefois indispensables aux férus d’histoire des techniques, aux experts en archéologie expérimentale ou aux passionnés d’histoire vivante…
Un savoir-faire contrôlé
À l’image des filigranes de nos billets de banque actuels, ce sont les graveurs qui apportaient la garantie visuelle de l’authenticité des pièces (les changeurs complétaient le contrôle par la vérification du poids grâce à leurs fameuses balances). En outre, avec l’introduction du portrait royal figuré sur les pièces depuis Louis XII (1498-1515), ce sont aussi les graveurs qui permettaient de diffuser l’effigie du monarque, ce sont donc eux qui permettaient au bon peuple de savoir à quoi ressemblait leur roi. Les graveurs assuraient ainsi la médiation entre le roi et ses sujets.
La fonction de graveur en monnaies était de première importance, c’est pourquoi cette profession était particulièrement encadrée, contrôlée et organisée par la Couronne.
 En 1547, le roi Henri II nomma Marc Béchot « tailleur sculpteur et graveur général des monnoyes de France ». Par sa lettre patente du 6 août 1548, le roi était on ne peut plus clair sur ses attentes : « estant nostre voulloir que touttes nos monoyes soient d’une mesme taille et poinson et que par ledict Béchot soit gravée et emprainte nostre pourtraicture es deniers d’or, escus et demis escus, testons et demis testons, au lieu de la croix que nous voulions estre ostée comme trop aisée à estre falcifiée… ». Béchot était depuis garant de l’uniformisation de l’image royale. À cette fin, il assurait la réalisation de tous les outillages monétaires utilisés dans les Monnaies du royaume ! Les graveurs locaux n’avaient plus quant à eux qu’à ajouter la date et la lettre de leur atelier sur les coins reçus de Paris. Béchot assura cette énorme tâche durant une dizaine d’années. Peu après sa mort, il fut remplacé le 24 novembre 1557 par Claude de Héry, maître orfèvre à Paris.
En 1547, le roi Henri II nomma Marc Béchot « tailleur sculpteur et graveur général des monnoyes de France ». Par sa lettre patente du 6 août 1548, le roi était on ne peut plus clair sur ses attentes : « estant nostre voulloir que touttes nos monoyes soient d’une mesme taille et poinson et que par ledict Béchot soit gravée et emprainte nostre pourtraicture es deniers d’or, escus et demis escus, testons et demis testons, au lieu de la croix que nous voulions estre ostée comme trop aisée à estre falcifiée… ». Béchot était depuis garant de l’uniformisation de l’image royale. À cette fin, il assurait la réalisation de tous les outillages monétaires utilisés dans les Monnaies du royaume ! Les graveurs locaux n’avaient plus quant à eux qu’à ajouter la date et la lettre de leur atelier sur les coins reçus de Paris. Béchot assura cette énorme tâche durant une dizaine d’années. Peu après sa mort, il fut remplacé le 24 novembre 1557 par Claude de Héry, maître orfèvre à Paris.
Mais, les années 1550 furent marquées par l’ouverture d’ateliers monétaires toujours plus nombreux et par l’augmentation exponentielle des frappes de testons et quarts d’écus favorisées par l’afflux d’argent hispano-américain. Il n’était plus possible au seul graveur général de fournir la totalité des coins monétaires utilisés dans le royaume. L’amplification des frappes monétaires ne put alors se faire que grâce à la contribution accrue des graveurs particuliers, tandis que la fonction du graveur général se bornait désormais à la réalisation des poinçons figurant le portrait du roi.
Qu’ils fussent graveurs généraux ou graveurs particuliers chacun de ces artistes jouaient un rôle capital dans le long processus technique de la production monétaire. Pour garantir la qualité de leur travail, la Couronne avait décidé que leur responsabilité personnelle serait désormais engagée. Au cours du XVIe siècle apparurent, à côté des marques (différents) des ateliers et de leurs directeurs (appelés maîtres), des symboles personnels constituant la signature de chaque graveur. Ainsi, à partir de la Renaissance, les pièces de monnaie ne portent plus seulement les symboles du roi : derrière chacune de ces petites œuvres de métal se cache un artiste, de moins en moins discret…