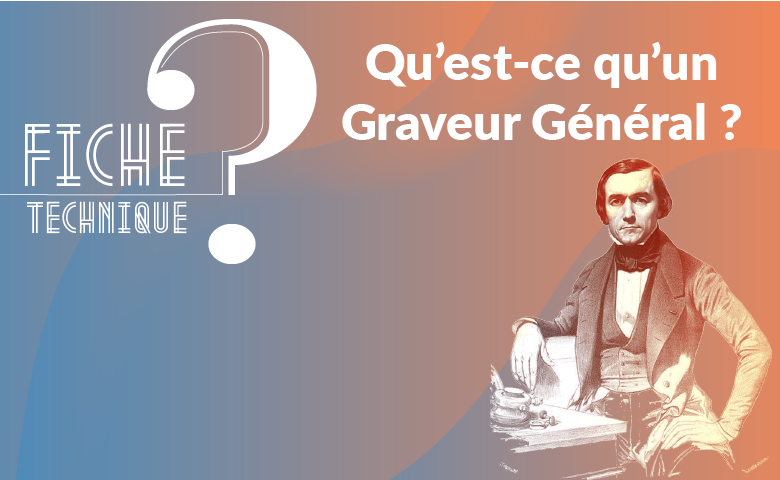Les fiches techniques donnent de précieux renseignements sur la monnaie, son histoire, ses coutumes, ses pratiques et ses traditions… La culture numismatique est importante, elle va de pair avec la collection. Elle nous permet de pouvoir saisir toute la richesse et la profondeur de la numismatique. Nous allons vous raconter l’histoire des Graveurs Généraux qui, aujourd’hui, n’existent plus mais qui ont marqué notre histoire monétaire.
© Par François BLANCHET
Après 211 années d’existence, c’est Dov Zérah, ancien Directeur de la Monnaie de Paris, qui mit fin au poste de Graveur Général, à son arrivée à la tête de la vénérable institution en août 2002. A tort ou à raison, le Graveur Général était souvent considéré comme le véritable « chef » de la Monnaie, au détriment du Directeur. D’ailleurs, dans les locaux de l’Atelier Monétaire français, il n’y a aucun salon qui porte le nom d’un ancien Directeur de la Monnaie de Paris. Tous portent le nom d’anciens Graveurs Généraux. Par le passé, c’est souvent lui qui recevait tous les honneurs. Depuis 16 ans, ce poste n’existe plus. C’est pourquoi, Yves Sampo qui signe aujourd’hui nos monnaies de son différent (une fleurette d’atelier) ne porte pas le titre de Graveur Général, mais celui de « Responsable de l’Atelier de Gravure de la Monnaie de Paris ». Créé en 1792, le Graveur Général aura vécu 211 ans. Titre honorifique et prestigieux certes, le Graveur Général a fait les belles heures de la numismatique française depuis la Révolution.


arborant l’Aile, différent du Graveur Général Lucien Bazor (1931-1958)
1791 : naissance des Graveurs Généraux
En France, avant 1791 chaque Atelier Monétaire du Royaume (et ils son nombreux à cette époque…) possédait son propre Directeur, qui signait les monnaies de son différent, indépendamment de sa zone géographique à cette époque. A partir de 1791 et du concours monétaire ayant eu lieu cette année là, un Graveur Général est choisi pour rayonner depuis Paris, sur l’ensemble des Ateliers Monétaires de France. C’est Augustin Dupré qui devient le premier Graveur Général. Il devient donc « directeur » de tous les lieux de frappe de notre pays, et supervise ainsi tous les chefs des ateliers de Province. C’est alors son différent qui figure sur toutes les monnaies de France, quel que soit leur atelier de production. Figure aussi, le différent de l’atelier en question. Lors de la suppression des ateliers de Province en 1880, les graveurs sont rapatriés à Paris puisque seule la Monnaie de Paris a le droit de frappe désormais, mais le principe ne change pas : les graveurs sont placés sous l’autorité du Graveur Général. Ce dernier ne grave pas systématiquement les monnaies qui sortent des ateliers, mais il en a la responsabilité (dessin, création, technique…).
Depuis la naissance de la fonction de Graveur Général, 13 illustres personnes se sont succédées à ce poste : Augustin Dupré (1791-1803), Pierre Joseph Tiolier (1803-1816), Nicolas Pierre Tiolier (1816-1843), Jean Jacques Barre (1843-1855), Albert Désiré Barre (1855-1878), Charles Marchais (1870-1871 / Bordeaux), Auguste Jean Barre (1879), Jean Lagrange (1880-1896), Henri Auguste Patey (1896-1930), Lucien Bazor (1931-1958), Raymond Joly (1958-1974), Emile Rousseau (1974-1994), Pierre Rodier (1994-2001). Tous ont choisi un différent particulier pour symboliser leur signature de Graveur Général sur les monnaies.
Cette fonction symbolique, mais ô combien prestigieuse a disparu depuis seize années maintenant. Les Responsables de l’Atelier de Gravure ont succédé aux Graveurs Généraux, pour effectuer un travail identique à celui de leurs prédécesseurs. Il s’agit donc d’un changement sur la forme, et non pas sur le fond. Car les missions sont similaires. Seul le titre de Graveur Général a été remisé aux oubliettes de la numismatique.

portant la Torche, différent du Graveur Général Henri Auguste Patey (1896-1930)